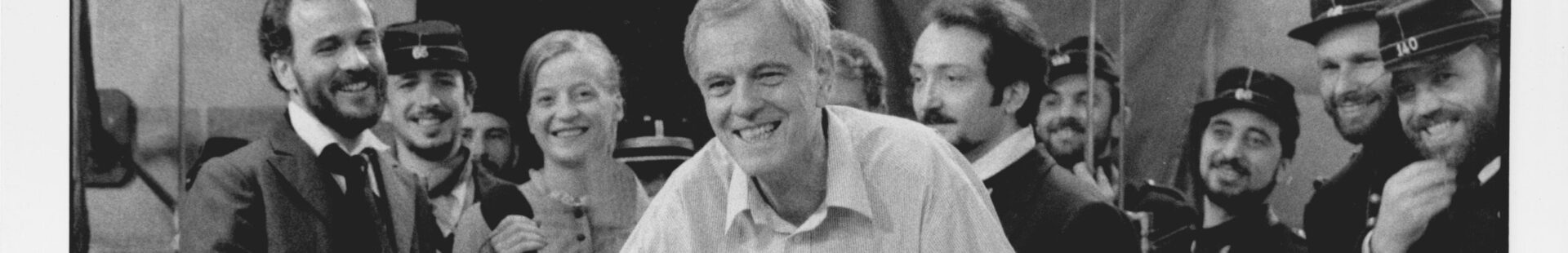
19 décembre 2025
Peter Watkins, exilé et nomade, explorateur des puissances empêchées du cinémapar Jean-Michel Frodon, critique et enseignant
Grande figure du cinéma de la deuxième moitié du 20e siècle, auteur d’une œuvre engagée, à contre-courant des modes, lauréat du Prix Charles Brabant de LaScam en 2005, Peter Watkins nous a quittés cette année. Il laisse derrière lui un héritage généreux et audacieux, une invitation à interroger notre regard sur le cinéma et les médias.
Quatorze films. C’est le nombre qui figure sur le site de Peter Watkins, et il faut donc lui accorder un certain crédit. Mais, durant des décennies (jusqu’à de bienvenues éditions DVD), quasiment personne n’a vu les courts métrages The Diary of an Unknown Soldier (1959), journal d’un soldat anglais tué dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, ou The Forgotten Faces (1961), sur l’insurrection de Budapest en 1956. Sans parler de The Field of Red (1958), sur la guerre de Sécession, ou La Gangrène (1963), sur la torture durant la Guerre d’Algérie, considérés comme perdus, et qui n’apparaissent pas dans cette liste. L’œuvre du cinéaste britannique mort à Bourganeuf (Creuse) le 31 octobre 2025, à l’âge de 90 ans, apport majeur au langage cinématographique composée de réalisations mémorables, est une œuvre en grande partie empêchée, marginalisée, composée de réalisations souvent interrompues en cours de production, ou à la diffusion contrariée ou carrément censurée. Le peu d’échos qu’a suscité sa disparition est à l’unisson de cette mise à distance, qui aura fait d’un explorateur extraordinaire des ressources de la caméra, de l’enregistrement sonore et du montage, un exilé et un nomade durant des décennies.
De la scène de théâtre aux écrans, sans rupture
Cinéaste ? C’est un des deux termes par lesquels il se définit (filmmaker) sur le site http://pwatkins.mnsi.net, le second étant media critic, où « critic » doit s’entendre au double sens de praticien d’une réflexion élaborée et argumentée et de contempteur implacable. Cinéaste, assurément, Peter Watkins ne « vient » pas du cinéma, encore moins de la cinéphilie telle qu’entendue en France à l’époque où lui-même se forme, dans les années 1950. Son premier environnement aura été le théâtre, au sein de plusieurs troupes implantées localement, en lien avec les collectifs de vie et de travail anglais et gallois qu’il fréquente. Cette approche est relayée ensuite par une pratique alors extrêmement dynamique et féconde, le film amateur, qui est à la fois un surgeon de l’école documentaire britannique des années 1930 et 1940 dont John Grierson et Humphrey Jennings ont été les figures de proue, et de l’activisme politique et syndical, très vivant dans le Royaume-Uni de l’après-guerre, et qui trouvera d’autres échos cinématographiques avec le mouvement des Angry Young Men et le Free Cinema (Karel Reisz, Tony Richardson, Lindsay Anderson, etc.). Ces environnements sont fondateurs d’une approche de la réalisation qui interrogera constamment à la fois ses propres méthodes (rapports à la technique, rapports sociaux dans le cadre de la fabrication) et les conditions de diffusion. Dans le contexte très particulier de l’audiovisuel britannique des années 60, et malgré un rapport très tôt conflictuel avec ses principales institutions (BBC, Granada TV), l’approche de Peter Watkins contribue, comme le fit autrement Ken Loach à l’époque de Cathy Come Home (1966) et de Poor Cow (1967), à pulvériser l’opposition entre cinéma et télévision comme la séparation entre fiction et documentaire, pour des approches de la réalité intuitives et sensibles, exigeantes sur le plan formel en relation directe avec les situations sociales ou historiques évoquées.
Recruté à la BBC en 1960 grâce à Visages oubliés, qui abordait déjà certaines pistes de réalisation qu’il développera ensuite, avec des acteurs s’adressant à la caméra comme dans un entretien télé et le recours aux photos de presse, Peter Watkins y réalise en 1964 son premier long métrage, l’impressionnant et fondateur La Bataille de Culloden. Cette reconstitution, avec peu de moyens, d’un affrontement historique qui vit en avril 1746 les troupes régulières anglaises écraser l’armée des Highlanders écossais, et massacrer les civils dans la foulée, établit d’emblée la singularité des méthodes de son réalisateur. Interprété par 142 lointains descendants des combattants, avec un grand souci du détail historique associé avec l’affirmation d’anachronismes évidents, le film est tourné comme par une caméra de télévision au cœur de l’action. Il offre une description inhabituellement crue de la réalité et de la brutalité des combats, qui est aussi à la fois une critique de la manière dont les films montrent d’ordinaire des batailles historiques et de la manière dont les reportages télé montrent des événements violents d’actualité. Vivant, charnel, d’une vigueur à la fois ironique et pleine d’empathie pour les braves gens envoyés s’entretuer pour la rivalité entre deux prétendants au trône, Culloden ne se contente pas de les montrer. Il leur donne la parole, selon des procédés de mise en abime à la fois réflexive et polémique (aussi par rapport aux lois du spectacle dominant) que Watkins ne cessera de développer et d’enrichir.
La Bombe et ses retombées
En 1965, La Bombe, qui associe archives, éléments documentaires, séquences de fiction réalistes et éléments de science-fiction, est un brûlot contre la menace nucléaire, qui déclenche des polémiques jusqu’à la Chambre des Communes et au 10 Downing Street. La BBC, qui l’a commandé, non seulement refuse de le diffuser, mais interdit à toutes les télévisions du monde de le montrer. Le film fera l’objet, dans de nombreux pays, de nombreuses projections en dehors des circuits classiques, accompagnées autant qu’il le peut par le cinéaste. Si la pugnacité idéologique du pamphlet est évidente, il faut aussi porter attention à la puissance et au dynamisme cinématographique qui en font à la fois un cauchemar digne du meilleur cinéma d’horreur et un document extrêmement précis, appuyés sur des faits patiemment enquêtés. Film de dénonciation anti-guerre et antinucléaire, pamphlet virulent contre l’autoritarisme, les mensonges d’État et les effets aussi absurdes que mortifères d’une politique existante tout autant que de leurs possibles conséquences catastrophiques, La Bombe est un impressionnant accomplissement cinématographique, vertigineux comme un film d’anticipation et tendu comme un thriller.
Furieux de la trahison de la chaine qui l’emploie, Watkins démissionne de la BBC. Il réalise, grâce au soutien d’une des stars du rock anglais d’alors, Paul Jones, le très singulier Privilège, première traduction explicite de l’autre manière qu’il aura de se qualifier, « critique des médias ». En plein boum du rock et de la pop, et alors que ces genres musicaux sont massivement considérés comme des formes d’expression de liberté d’une jeunesse qui s’émancipe des conventions et des conformismes, le film dénonce la manière dont l’industrie du spectacle dévoie les légitimes volontés de révolte sociale et politique de cette même jeunesse en idolâtrie pour ces produits de consommation de masse que sont les groupes et les chanteurs. Sur les scènes d’hystérie collectives déclenchées par une rock star interprétée par Paul Jones, la voix off de Peter Watkins en explicite les mécanismes, et ses effets sur la société. Volontairement caricatural dans sa critique, il déploie un argumentaire plus complexe qu’il ne parait, en particulier en reliant les deux sens du terme « idole », dans l’industrie du spectacle et dans la religion, et en suggérant des continuités esthétiques entre le fascisme et le showbizness. Méthodiquement démoli par la presse britannique, le film pourtant produit – c’est la seule fois dans le parcours de Watkins – par un grand studio hollywoodien, est retiré de l’affiche après quelques jours. Toujours très attaqué à propos de La Bombe, et après un projet inabouti de film avec Marlon Brando sur le génocide des autochtones amérindiens aux États-Unis, le cinéaste quitte en 1968 le pays où il se sent rejeté. Il n’y habitera plus jamais.
Peter Watkins s’installe en Suède, à l’invitation d’une société de production et de distribution, Sandrews. Alors que se multiplient les soulèvements et contestations qui marquent l’année 68, il y réalise une fable satyrique et pacifiste, Les Gladiateurs, elle aussi immédiatement rejetée par le marché et les grands médias. Le réalisateur quitte la Suède. En lien direct avec l’escalade de l’agression étatsunienne au Vietnam, et de la répression du mouvement anti-guerre dans le pays, Peter Watkins réalise Punishment Park, bien accueilli au Festival de Cannes 1971 mais banni aux États-Unis. Faux documentaire prétendument tourné par une équipe de télé européenne, le film met en scène les effets d’une possible déclaration de l’Etat d’urgence fédéral par le président Nixon, entrainant la mise en place d’épreuves ultra-violentes auxquelles sont condamnés les opposants à la politique du pays et à la poursuite de la guerre en Asie du Sud-Est. Leur calvaire dans un désert du Sud californien est du même mouvement dénonciation des possibles dérives ultra-autoritaires du pouvoir et questionnement des attentes et des réactions des spectateurs.
Edvard Munch, travail de génie
Après un projet, State of the Union, qui renouait avec un de ses premiers courts métrages, autour de photos de la guerre de Sécession, Peter Watkins s’installe en Norvège. Il y réalise en 1973 un film qui occupe une place singulière dans son parcours, par son ampleur, la singularité des moyens de mise en scène, l’importance de la matière de l’image, des rapports au temps, la complexité des relations entre individu et collectivité, art et société, passé et présent qu’il instaure. Consacré au peintre qui lui donne son nom, Edvard Munch, la danse de la vie est sans conteste l’un des rares sommets de l’histoire des films consacrés à des peintres – « un travail de génie » selon Ingmar Bergman. Il est singulier, et finalement réjouissant, qu’il soit parfois classé comme documentaire. La reconstitution de l’existence tourmentée de l’artiste de la fin du 19e siècle interprété par Geir Westby, de sa famille, de ses troubles mentaux, des rejets dont il a fait l’objet de la part de la société et des milieux artistiques, de ses engagements esthétique et politiques, est d’une précision méticuleuse, mais en effet filmée comme au présent, sur le vif. Watkins y mobilise les procédés qu’il a mis en place depuis Culloden, avec adresse directe à la caméra des personnages, interviews improvisées de figurants, et mouvements d’appareils évoquant le reportage plutôt que le film d’époque. Réalisé en deux formats, trois heures pour la salle de cinéma et une demi-heure de plus pour la télévision, le film travaille l’attention aux lumières, la matérialité des objets, le vertige des mots (empruntés au journal du peintre), la violence des rapports humains, avec une sensibilité à vif, qui cherche constamment la sensation plutôt qu’une authenticité d’antiquaire. Plus intuitif que descriptif, le montage suit lui aussi les énergies qui parcourent l’œuvre de l’auteur Cri, à partir de ce qu’il est possible de relier à des moments de sa vie, plus exactement des années de jeunesse. La voix off de Watkins apportant des informations historiques devient, autant qu’un pont informatif, un ressort romanesque, entre passé et présent, dans la vibration mystérieuse et émouvante de ce que cet anti-biopic a d’un autoportrait.
La critique des médias
Au cours des années 1970, entre Scandinavie, États-Unis et Australie, le cinéaste aura ensuite de multiples projets, dont la plupart resteront inaboutis. Il signe un long métrage sur le suicide chez les jeunes Danois qui demeure invisible, 70’ernes Folk (« Gens des années 70 »), un moyen métrage imaginant la célébration de l’an 2000 dans un centre de stockage de déchets nucléaires, Fällan (« Le Piège »), pour la télévision suédoise, également disparu. Parallèlement, grâce à des recherches menées avec des groupes d’universitaires et d’étudiants aux États-Unis, en particulier un séminaire à l’université de Columbia à partir de 1977, il développe sa réflexion sur le rôle et le fonctionnement des médias, et met en place les deux outils théoriques qu’il nomme MMAV (pour mass media audiovisuel) et « monoforme », qui désigne le schéma répétitif des productions grand public, aussi bien les films de fiction que les émissions d’information. Watkins élabore ainsi les éléments d’une déconstruction du spectacle audiovisuel, aussi bien dans ses formes informatives et journalistiques que de distraction, qui sont en grandes partie des traductions au présent des critiques de la culture de masse telles que formulées par l’École de Frankfort des décennies plus tôt.
Cette approche organise la réalisation du long métrage Evening Land (Force de frappe), politique fiction mettant en jeu à la fois une lutte syndicale ayant effectivement eu lieu en Suède à ce moment, pour les salaires et contre la construction de sous-marins équipés d’ogives atomiques, et une action (fictionnelle) d’un groupe armé contre un congrès européen, ainsi que des méthodes de la police pour le réprimer. Les télévisions scandinaves, coproductrices, sont unanimes pour refuser le film. Le cinéaste se lance ensuite dans un immense projet, qui l’occupera plusieurs années, avec des tournages sur les cinq continents, à chaque fois en relation étroite avec les personnes et les collectivités qu’il filme. Il en résulte, en 1987, un film de 14h40, Le Voyage, sous-titré « Une odyssée globale pour la paix », financé par des collectes dans quinze pays, et qui revendique de bouleverser de manière plus radicale encore que les précédents films les habitudes de production et les formes usuelles de réception.
De Strindberg à La Commune, radicalisation des expériences
En 1992, il mène à bien la réalisation d’un long métrage envisagé depuis quinze ans, et consacré à August Strindberg. Il était conçu à l’origine comme un pendant à Edvard Munch, que Watkins considère désormais comme trop complaisant envers les diktats de la « monoforme ». Le Libre-penseur est cette fois co-réalisé, en vidéo, avec vingt-quatre étudiants suédois, actifs à tous les postes de la production, ajoutant de nombreuses scènes de leur cru à une œuvre qui durera 4h30. Selon les propres termes de Watkins, qui synthétise en fait ce qui aura dicté toute sa démarche au cours des décennies, « Le Libre-penseur s’attache à montrer : a) comment des formes non-orthodoxes de langage cinématographique élargissent notre vision de l’Histoire, et notre manière d’entrer en relation avec les personnes sur l’écran, et entre nous. b) qu’il existe d’autres façons de produire du matériel audiovisuel les méthodes rigidement centralisées utilisées par les MMAV. c) que, au contraire de ce qu’on voit à la télé, il existe des processus alternatifs également pour les spectateurs – grâce auxquels ils peuvent devenirs des participants conscients plutôt que des récepteurs passifs et hiérarchiquement dominés »[1]. La mise en œuvre du film repose sur de longues discussions entre tous les participants, dont plusieurs figurent dans le film.
En 1999, Peter Watkins trouve la possibilité de pousser plus loin ces recherches, tout en les mettant en œuvre à propos d’un événement révolutionnaire majeur. La Commune (de Paris, 1871). S’appuyant cette fois sur une rigoureuse chronologie, le projet invite les dizaines de participants assemblés dans les anciens studios Méliès à Montreuil à réfléchir comment montrer et raconter les différents épisodes de l’insurrection, ses enjeux, ses contradictions, la richesse des idées qui y ont émergé. D’une durée de 5h45, avec une version de 3h30 pour la salle de cinéma, le film intègre en permanence les questionnements au présent sur les formes du récit, le sens des interprétations, les conditions de réalisation, ce que les événements de 1871 inspirent aux hommes et aux femmes de 1999, dont beaucoup sont engagés dans les luttes politiques et sociales en cours. Face à la Télévision Nationale Versaillaise matérialisant le point de vue des médias dominants, une Télévision Communale donne forme à des éléments de ce que pourrait être, et faire, un média non-inféodé aux oppresseurs. La Commune bénéficiera d’une diffusion sur Arte, et d’une circulation en salles, modeste mais réelle, avant d’être édité en DVD – comme désormais, chez Potemkine, la quasi-totalité des films accessibles.
[1] Texte figurant sur le site http://pwatkins.mnsi.net. Ma traduction.
Une pensée en actes, une forme qui pense
Ces réalisations s’inscrivent de manière de plus en plus organique dans l’ensemble des réflexions sur le système médiatique (dont fait partie, pour Watkins, le cinéma), réflexions qui trouveront une formalisation avec la parution du livre Media Crisis en 2003 (traduction française par Patrick Watkins, désormais aux éditions L’Échappée). Cet ensemble de commentaires et de propositions est en grande partie pertinent, même si moins riche de sens que les pratiques expérimentées par Watkins dans la réalisation de ses films. Au-delà de la singularité de chaque projet, et des conditions matérielles, pratiquement toujours difficiles, dans lesquelles il a pu les mettre en œuvre, il s’y active en effet un ensemble de stratégies qui frappent par leur ambition et leur cohérence. Il s’agit en effet toujours de trouver des procédures interrogeant de manière critique à la fois le « sujet » du film, les dispositifs de réalisation mobilisés, les conditions de production et de distribution, les formes de réceptions et de possibles répercussions par les spectateurs. Watkins, bien avant la célèbre injonction de Jean-Luc Godard, a cherché à « faire politiquement des films politiques », en mettant en question l’ensemble des procédés activés par l’existence d’un film. L’expérimentation simultanée à de multiples niveaux nourrit ce que des universitaires ont appelé son « insurrection médiatique » (titre de l’ouvrage collectif dirigé par Sébastien Denis et Jean-Pierre Bertin-Maghit, aux Presses universitaires de Bordeaux). L’ambition jamais reniée du projet, et l’inventivité des manières de le mettre en œuvre, ont donné des œuvres d’une puissance et d’une beauté incontestables – La Bataille de Culloden, La Bombe, Punishment Park, Edvard Munch assurément. Ces titres suffiraient à inscrire leur auteur parmi les grandes figures du cinéma de la deuxième moitié du 20e siècle. Mais il y a plus et, peut-être, mieux : si chacune et chacun appréciera plus ou moins tel ou tel film, la nature même de ceux-ci mène quiconque les regarde avec un minimum d’honnêteté à s’interroger sur ses propres critères de goût, la nature de ses attentes, et à quels modèles elles renvoient. Il ne s’agit pas de se forcer à aimer des films, il s’agit de ne pas se contenter des capacités que chacune et chacun possède d’entrer d’emblée en sympathie avec eux. Aussi parce que la démarche du réalisateur est profondément généreuse, attentive aux êtres et aux relations, l’invitation critique dans ce qu’elle a de plus constructif et de plus stimulant est un trésor comme bien peu d’autres cinéastes en offrent.
Jean-Michel Frodon est journaliste, critique de cinéma et enseignant, notamment à Sciences Po Paris (SPEAP, Programme d’expérimentation en art politique), et professeur honoraire de l’université de Saint Andrews (Écosse). Il a été responsable des pages cinéma du « Monde » et a été directeur des « Cahiers du cinéma », il collabore aujourd’hui régulièrement aux sites d’information « Slate.fr » et « AOC » et à de nombreuses publications françaises et étrangères. L’ensemble de ses textes est accessible sur son blog « Projection publique ». Il est l’auteur ou le directeur d’une trentaine d’ouvrages sur le cinéma dont « Le Cinéma français de la Nouvelle Vague à nos jours », « La Projection nationale », « Le cinéma et la Shoah », « Robert Bresson », « Conversation avec Woody Allen », « Le Cinéma chinois », « Gilles Deleuze et les images », « L’Art du cinéma », « Le Monde de Jia Zhang-ke », « Cinémas de Paris », « Chris Marker », « 13 Ozu », « Abbas Kiarostami, l’œuvre ouverte », « Le Cinéma à l’épreuve du divers », « Le Cinéma d’Edward Yang ». Il est également commissaire d’exposition, auteur d’installations vidéo et programmateur.


